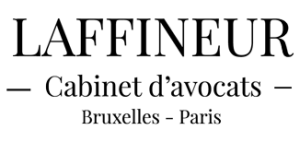La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) condamne la Pologne pour avoir interdit de manière absolue la publicité des pharmacies, une mesure jugée excessive au regard des exigences du droit de l’Union.
Résumé
L’arrêt du 19 juin 2025 C‑200/24 rendu par la CJUE porte sur un recours en manquement introduit par la Commission européenne contre la Pologne. La Commission reprochait à la Pologne d’avoir instauré une interdiction générale et absolue de la publicité pour les pharmacies, ce qui violerait à la fois les libertés de circulation garanties par les articles 49 et 56 du TFUE (liberté d’établissement et libre prestation de services), et l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique. La CJUE a jugé que cette interdiction constituait une mesure disproportionnée, non justifiée par la protection de la santé publique, et contraire aux principes fondamentaux du droit de l’Union. Elle condamne dès lors la Pologne pour manquement à ses obligations.
Faits
La législation polonaise en cause, et plus précisément l’article 94a de la loi pharmaceutique, interdit toute forme de publicité pour les pharmacies et les points de vente pharmaceutiques. Seules les informations strictement nécessaires à l’identification d’une pharmacie, comme son nom, son adresse et ses horaires d’ouverture, sont autorisées. Toute infraction à cette interdiction est passible d’une amende pouvant atteindre 12 000 euros.
Cette législation a été adoptée par la Pologne dans un objectif affiché de protection de la santé publique, en cherchant à limiter la consommation excessive de médicaments, ainsi qu’à garantir l’indépendance professionnelle des pharmaciens. Toutefois, cette interdiction s’appliquait uniformément à toutes les pharmacies, quel que soit leur mode de fonctionnement ou leur public cible, y compris celles qui proposaient des services en ligne.
La Commission européenne, estimant que cette disposition enfreignait le droit de l’Union, a engagé une procédure de recours en manquement devant la CJUE.
Arguments des requérants
La Commission soutenait que l’interdiction imposée par la législation polonaise violait deux ensembles de normes européennes. Premièrement, la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique, notamment son article 8, paragraphe 1, qui garantit aux membres des professions réglementées (comme les pharmaciens) la possibilité d’avoir recours à des communications commerciales en ligne, sous réserve du respect des règles professionnelles. Et deuxièmement, les articles 49 et 56 TFUE, relatifs à la liberté d’établissement et à la libre prestation de services dans l’Union.
Selon la Commission, l’interdiction polonaise constitue une restriction générale et absolue des communications commerciales, incompatible avec le droit de l’Union. Elle se réfère à la jurisprudence Vanderborght (C‑339/15), dans laquelle la CJUE avait déjà condamné une interdiction similaire de publicité dans le domaine des soins dentaires.
Elle ajoutait que cette interdiction nuisait à l’accès au marché pour les nouvelles pharmacies, notamment étrangères, et faussait la concurrence, en empêchant une communication équitable avec les consommateurs. De plus, la Pologne n’avait pas démontré que cette mesure était nécessaire pour atteindre l’objectif invoqué qui est la protection de la santé publique. Selon la Commission, des mesures moins restrictives auraient suffi, comme un encadrement du contenu de la publicité ou des obligations d’information.
Décision/appréciation de la cjue
La CJUE a donné raison à la Commission européenne sur l’ensemble des griefs. Elle constate en premier lieu que l’interdiction générale de publicité constitue une restriction aux communications commerciales au sens de la directive 2000/31/CE. Or, cette directive exige que de telles restrictions soient proportionnées, c’est-à-dire qu’elles ne doivent pas aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour atteindre un objectif d’intérêt général.
La Cour rappelle qu’une interdiction absolue ne peut être justifiée que dans des cas exceptionnels, ce qui n’est pas démontré ici. La Pologne n’a apporté aucune preuve tangible que cette interdiction aurait un effet réel sur la réduction de la consommation excessive de médicaments. En outre, elle n’a pas démontré qu’un encadrement du contenu publicitaire, moins intrusif, n’aurait pas suffi.
Concernant la violation des libertés fondamentales (articles 49 et 56 TFUE), la CJUE souligne que l’interdiction crée un désavantage concurrentiel pour les nouvelles pharmacies, en particulier celles qui souhaitent s’établir sur le marché polonais. Elle empêche les opérateurs économiques de faire connaître leurs services et constitue donc une entrave injustifiée à la libre concurrence et à la liberté d’établissement.
La Cour estime enfin que, même si la protection de la santé publique constitue un objectif légitime, elle ne saurait justifier une mesure aussi radicale et indiscriminée, en l’absence de preuves concrètes de son efficacité.
Conséquences pratiques de l’arrêt
Par cet arrêt, la CJUE condamne la Pologne pour manquement à ses obligations en vertu du droit de l’Union. La Pologne est donc tenue de modifier sa législation afin de la rendre conforme au droit européen. Elle devra permettre aux pharmacies de faire de la publicité, sous réserve du respect des règles déontologiques professionnelles.
Pour les pharmacies établies en Pologne, cet arrêt ouvre désormais la possibilité de communiquer librement sur leurs services, y compris par voie électronique à condition de respecter certaines limites raisonnables fixées par la réglementation nationale.
Pour les États membres en général, l’arrêt rappelle fermement que toute restriction aux libertés économiques doit être dûment justifiée et proportionnée. L’invocation d’objectifs légitimes comme la santé publique ne suffit pas : il faut démontrer que la mesure est nécessaire et adéquate, et qu’aucune alternative moins contraignante n’est possible.
En somme, cet arrêt renforce la jurisprudence européenne en matière de communications commerciales dans les professions réglementées, en réaffirmant la primauté du principe de proportionnalité et en facilitant l’ouverture des marchés nationaux à une concurrence loyale et transparente dans le cadre du marché intérieur de l’Union européenne.